

Célébrations de l’abolition
L’étude comparée des mouvements abolitionnistes en Europe et aux États-Unis révèle que l’abolition de la traite et de l’esclavage ne fut jamais une question simple et facile. Alors qu’émerge l’humanisme européen, il faut pouvoir justifier la capture, l’asservissement et la déportation d’êtres humains. La doctrine de justification va s’élaborer de manière graduelle, mêlant arguments religieux (la « condamnation de Cham »), économiques et racistes. Le discours abolitionniste lui aussi s’élabore en empruntant ses arguments à plusieurs sources, morales, religieuses et économiques. L’histoire de l’abolitionnisme est une histoire complexe où dialoguent et s’affrontent le tolérantisme - doctrine de ceux qui inscrivent la pratique de l’esclavage dans l’histoire longue de l’humanité et ne voient pas de nécessité à la bannir à court terme, en cherchant à s’accommoder d’un système que réprouve la morale chrétienne -, le gradualisme -, doctrine prônant des réformes lentes et progressives des sociétés coloniales esclavagistes, précédées d’une abolition immédiate de la traite et destinées à mettre en place une transition pacifique entre travail servile et travail libre, entre esclavage et citoyenneté - et l’immédiatisme, tardivement formulé par le mouvement antiesclavagiste, défendant une abolition radicale, pure et simple, de l’esclavage. Les immédiatistes en appellent à l’impératif moral, qui ne souffre aucun délai et doit trouver une application immédiate.
Le mouvement abolitionniste en France a été long à s’organiser. Certes, des voix se font fait entendre pour dénoncer la profonde contradiction à se dire hérauts de la liberté et de la fraternité et à priver de liberté des êtres humains, mais il n’a existé aucun large mouvement social pour défendre et soutenir cette revendication. Portée par l’aspiration des esclaves à la liberté, la Révolution haïtienne et les idéaux des Lumières et de la Révolution française, l’abolition du 4 février 1794 est un décret au destin variable. Il est appliqué à Saint-Domingue, en Guadeloupe et en Guyane, mais pas dans les colonies de l’océan Indien (île de France et île Bourbon), ni en Martinique sous occupation anglaise. En 1802, l’esclavage est rétabli par Bonaparte en Guadeloupe et en Guyane, et le Code Noir est restauré. Alors que nombre d’institutions qui fondent la République (code pénal, code civil, administration des communes...) sont créées en France, la colonie demeure espace d’exception et d’arbitraire.
Au cours des années qui suivent l’abolition de 1794 et le rétablissement de 1802, l’opinion française reste en grande partie indifférente et les manifestations abolitionnistes marginales. Le courant gradualiste domine chez les élites. En 1848, le courant immédiatiste s’impose et la IIe République décrète le 27 avril l’abolition de l’esclavage. L’argument moral l’a emporté. Cependant, si l’esclavage est aboli, l’affranchi va en porter longtemps la marque : citoyen, il demeure un colonisé et ce statut justifie que perdure l’inégalité.
L’abolition de 1848 ne saurait donc apparaître comme seule date fondatrice de l’avènement de la citoyenneté. Certes, elle marque une rupture entre servitude et liberté, mais cette dernière est vécue comme une promesse plutôt que comme un fait. L’abolition ne met fin ni au racisme ni aux inégalités. Comment à la fois célébrer la liberté et ce qui la limite ? Les recherches historiques décrivent en effet les contradictions des sociétés postabolitionnistes, où la fraternité républicaine se révèle limitée, entravée, presque impossible. Ces recherches montrent que, durant la période postesclavagiste, l’aristocratie de la terre s’efforce de limiter l’accès aux libertés civiques des affranchis et des « engagés », ces femmes et ces hommes qui prennent la place des esclaves sur les plantations. Le gouvernement provisoire de la IIe République avait institué le suffrage masculin universel le 5 mars 1848, et l’étude de la campagne électorale dans les colonies révèle quel enjeu représente cette loi. Aux Antilles, les candidats prônent tous « l’oubli du passé » au nom de la « réconciliation sociale ». Les maîtres mots sont « Ordre et Travail ». Ainsi, Schoelcher déclare à ses électeurs : « Travaillez, vous que la patrie admet au rang de ses fils ; c’est par le travail que vous conquerrez l’estime de vos concitoyens d’Europe. » À la Réunion, les colons déclarent : « Sont-ils français ces Cafres, ces Malgaches, ces Malais, esclaves de leur pays, qui ont été importés dans la colonie et qui y ont vécu esclaves ? » Il faut faire en sorte que les « Noirs épargnent à l’urne française l’humiliation de recevoir des suffrages africains ».
Il ne s’agit pas de sous-estimer l’importance du passage du statut d’esclave à celui d’homme libre, mais de découvrir les limites de l’abolition de 1848 elle-même, les nouvelles formes de servitude et d’exclusion qu’elle entraîna, les lois et les techniques de discipline qui furent élaborées pour transformer l’esclave (être qui, selon l’idéologie esclavagiste, était irrationnel, irresponsable et ne travaillait que sous la menace du fouet) en un individu rationnel, responsable et ayant intégré l’amour du travail salarié. Il s’agissait de remplacer le fouet par le contrat obligatoire et le collier de servitude par la culpabilité. Dans toutes les colonies, l’abolition fut présentée comme un don de la France, mettant ainsi en dette celles et ceux qu’elle avait asservis. L’inclusion des nouveaux citoyens s’avéra problématique. Ces derniers furent accablés sous le poids d’un fardeau moral : ils devaient par leurs attitudes, leurs déclarations se montrer « dignes » d’une citoyenneté qui, pour eux, n’était pas un droit, mais un devoir. Au cours des années suivantes, les inégalités et le racisme perdurèrent.
Les premières célébrations de l’abolition marquent bien ces ambiguïtés : à la fois célébrer la liberté et maintenir le statut colonial entraînant inévitablement inégalités sociales et économiques, ainsi qu’un ordre social racialisé. Ainsi, aux Antilles et à la Réunion, la célébration de l’abolition devient « fête du travail » et le « bon » travailleur est celui qui a prouvé sa soumission aux nouvelles règles. L’ironie de ces célébrations n’échappe pas aux affranchis.
Dans les colonies, après l’abolition, un sentiment de frustration voit le jour ; en France métropolitaine, on tire un trait sur cette histoire. L’abolition entraîne en effet un effacement de ces sociétés de l’histoire nationale. La traite et l’esclavage ne sont intégrés dans aucun des grands textes fondateurs qui construisent le récit de la nation dans cette période de la fin du XIXe siècle durant laquelle se forge la mémoire républicaine. Aucun des grands historiens français du moment ne se penche sur l’esclavage et son abolition ; aucun roman abolitionniste ne connaît le succès de La Case de l’Oncle Tom ; aucun des grands débats politiques de la IIIe République ne soulève la question du devenir des populations des colonies post-esclavagistes. Le décret d’abolition de 1848 avait reconnu les affranchis comme citoyens, mais leur histoire, leur culture, leurs apports à la France demeurèrent ignorés.
Ce silence, analysé par de nombreux historiens, explique en partie le sentiment de déni « organisé » d’une histoire vécue comme centrale par ces populations ; c’est cependant un silence général, car, dans les sociétés post-esclavagistes, on n’assiste à aucune campagne de collecte de témoignages d’esclaves, ni de collecte de mémoires par les affranchis éduqués ou les abolitionnistes. C’était pourtant une occasion extraordinaire, un travail qui aurait pu être fait, et l’absence de cette archive est une donnée importante à analyser. Les affranchis voulaient sans doute oublier une vie liée à un statut qui signifiait dévalorisation, déshumanisation, exclusion du lien social. Mais ce désir d’oublier tout à fait compréhensible a entraîné un silence honteux, car comment effacer une telle expérience ? On ne peut donc accuser une seule des parties : le silence fut double, dans l’histoire nationale et dans les histoires locales, bien que les raisons de l’oubli ne fussent pas les mêmes. Les mémoires singulières et collectives de l’esclavage vont survivre oralement, dans les mythes, les contes et les rites, mais cette mémoire orale irremplaçable n’a été explorée et restituée en partie que depuis une vingtaine d’années seulement.
En 1948, le centenaire du décret est célébré officiellement à la Sorbonne, mais avec une remarquable discrétion, en présence de Gaston Monnerville et Aimé Césaire. Depuis deux ans, les « Vieilles Colonies » - Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion - étaient devenues des départements français. Les descendants d’esclaves, citoyens depuis 1848, n’étaient désormais plus des colonisés. Lors de cette commémoration, Aimé Césaire définissait cette date comme « à la fois immense et insuffisante », car « le racisme est là. Il n’est pas mort ». Cette lecture critique du rôle d’un État qui aurait dû être le garant de la liberté promise pointait l’absence d’une réelle prise de conscience sur ce qui aurait dû constituer une abolition dans toutes ses dimensions culturelles, économiques et sociales. Cette lecture des événements signalait aussi que les institutions mises en place après l’abolition étaient restées coloniales, freinant, sinon bloquant les transformations promises par l’abolition. Mais, surtout, la longue histoire des résistances des esclaves, de leurs créations originales (culturelles et sociales) demeurait ignorée, oubliée.
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, aux Antilles, c’est « Papa Schoelcher » que l’on fête le 27 avril. À la Réunion, c’est une date qui n’est pas reconnue officiellement, mais célébrée clandestinement. Les stigmates de l’esclavage pèsent encore. Il faudra attendre les années 1970 pour que, dans ces sociétés, commence un travail de réappropriation de cette histoire, de valorisation des apports des esclaves à leur culture et à leur histoire. La traite négrière et l’esclavage ont provoqué une honte collective, la dévalorisation de l’être et du « Noir » a été intégrée, honte qui s’exprime dans les langues créoles, dans les stéréotypes discriminatoires qu’elle véhicule, et dans la difficile intégration sociale de ce passé par celles et ceux qui en ont hérité. La honte s’est transmise socialement et dans les familles. L’école n’a pas rempli son rôle pédagogique : longtemps, les manuels scolaires n’ont pas fait état de cette histoire. Plus récemment, les médias, télévision et radios, dont on reconnaît l’impact sur la culture et le social, n’ont pas non plus soutenu un travail de remémoration et de réinterprétation.
En 1983, la loi n° 83-550 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage institue la date retenue par chaque département d’outre-mer comme étant fériée. Le travail de réappropriation continue et l’esclavage devient alors le sujet de nombreuses études, il inspire artistes et romanciers. Le sentiment perdure cependant que la nation continue à négliger l’importance de cette histoire pour elle-même et pour certains de ses citoyens.
Le cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998, ravive le désir de faire entendre la mémoire de l’esclavage. L’esclavage - « barbarie civilisée », pour reprendre l’expression d’Aimé Césaire - revient hanter le récit national et républicain. Cependant, la commémoration, tout en réactualisant la problématique de la traite, de l’esclavage et de ses abolitions ne réussit pas à produire un mouvement de sensibilisation nationale : pas d’histoire socialisée de l’esclavage, aucun événement médiatique qui fasse date. À la suite de 1998, il y a eu des frustrations, le sentiment d’une marginalisation du crime. Nombreux ont été ceux qui ont accusé l’esclavage d’être source de tous les maux dont souffrent les sociétés qui en sont issues.
La loi du 21 mai 2001, portée par le mouvement de 1998 et la réactualisation dans le monde des réflexions portant sur les séquelles de l’esclavage, notamment sur le continent africain, a de nouveau ravivé l’attente d’initiatives concrètes : une transformation des programmes scolaires, une création de lieux de mémoire, un geste symbolique.
On le voit, la célébration de l’abolition n’a pas été sans problèmes. Il s’agit maintenant de dépasser une tension entre deux mémoires devenues pour certains antagoniques, mais que nous pensons fructueuse et fertile. Entre un « ce n’est jamais le bon geste, ce n’est pas assez » et un « mais que faut-il de plus ? », il faut créer l’espace commun où dialoguent ces mémoires en vue d’une synthèse partagée. Dans cette perspective, l’inscription d’un jour solennel de commémoration dans le calendrier national serait la pierre la plus immédiatement visible de l’édifice mémoriel à construire.
CONTACT
Président :
Frédéric REGENT
Assistante de direction
Chargée de communication:
Magalie LIMIER
CNMHE
Ministère des Outre-Mer
27 rue Oudinot 75007 PARIS
Mail : sec-cnmhe@outre-mer.gouv.fr
LIENS
![]()

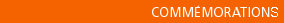
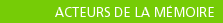
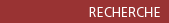
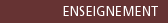


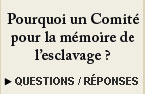
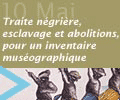




Suivez l'actualité du CNMHE
sur Facebook et Twitter